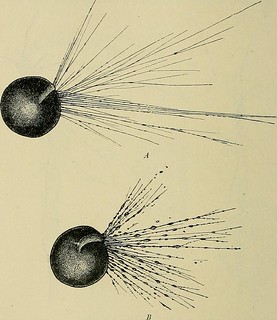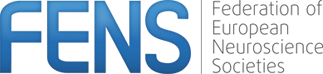- External URL
- Born
-
Date: 18 Oct 1859
- Died
-
Date: 4 Jan 1941
- No links match your filters. Clear Filters
-
 Born
Born
18 Oct 1859
-
 Died
Died
4 Jan 1941
-
Quoted by
 'La Théorie de la relativité: séance du 6 avril 1922', Bulletin de la Société française de philosophie 22 (3) (1922), pp. 91-113.
'La Théorie de la relativité: séance du 6 avril 1922', Bulletin de la Société française de philosophie 22 (3) (1922), pp. 91-113.
Description:'M. Le Roy: ... J'estime en particulier que le problème du temps n'est pas le même pour M. Einstein et pour M. Bergson. Il y aurait sur ce point plusieurs remarques à faire. Mais, M. Bergson étant parmi nous, ce n'est pas à moi qu'il appartient de les produire ; et mon intervention aura eu tout l'effet que je désire si elle amène M. Bergson lui-même à prendre la parole.
M. Bergson. – J'étais venu ici pour écouter. Je n'avais pas l'intention de prendre la parole. Mais je cède à l'aimable insistance de la Société de philosophie.
Et je commence par dire à quel point j'admire l'œuvre de M. Einstein. Elle me paraît s'imposer à l'attention des philosophes autant qu'à celle des savants. Je n'y vois pas seulement une physique nouvelle, mais aussi, à certains égards, une nouvelle manière de penser.
Un approfondissement complet de cette œuvre devrait naturellement porter sur la théorie de la Relativité généralisée aussi bien que sur celle de la Relativité restreinte, sur la question de l'espace aussi bien que sur celle du temps. Puisqu'il faut choisir, je prendrai le problème qui m'intéresse spécialement, celui du temps. Et puisqu'il ne faudrait pas parler du temps sans tenir compte de l'heure, et que l'heure est avancée, je me bornerai à des indications sommaires sur un ou deux points. Force me sera bien de laisser de côté l'essentiel.
Le sens commun croit à un temps unique, le même pour tous les êtres et pour toutes choses. D'où vient sa croyance ? Chacun de nous se sent durer : cette durée est l'écoulement même, continu et indivisé, de notre vie intérieure. Mais notre vie intérieure comprend des perceptions, et ces perceptions nous semblent faire partie tout à la fois de nous-mêmes et des choses. Nous étendons ainsi notre durée à notre entourage matériel immédiat. Comme, d'ailleurs, cet entourage est luimême entouré, et ainsi de suite indéfiniment, il n'y a pas de raison, pensons-nous, pour que notre durée ne soit pas aussi bien la durée de toutes choses. Tel est le raisonnement que chacun de nous esquisse vaguement, je dirais presque inconsciemment. Quand nous l'amenons à un degré supérieur de clarté et de précision, nous nous représentons, au delà de ce qu'on pourrait appeler l'horizon de notre perception extérieure, une conscience dont le champ de perception empiéterait sur le nôtre, puis, au delà de cette conscience et de son champ de perception, une autre conscience située d'une manière analogue par rapport à elle, et ainsi de suite encore, indéfiniment. Toutes ces consciences, étant des consciences humaines, nous paraissent vivre la même durée. Toutes leurs expériences extérieures se dérouleraient ainsi dans le même temps. Et comme toutes ces expériences, empiétant les unes sur les autres, ont, deux à deux, une partie commune, nous finissons par nous représenter une expérience unique, occupant un temps unique. Dès lors nous pouvons, si nous le voulons, éliminer les consciences humaines que nous avions disposées de loin en loin comme autant de relais pour le mouvement de notre pensée : il n'y a plus que le temps impersonnel où s'écoulent toutes choses. Voilà le même raisonnement sous une forme plus précise. Que nous restions, d'ailleurs, dans le vague ou que nous cherchions la précision, dans les deux cas l'idée d'un temps universel, commun aux consciences et aux choses, est une simple hypothèse.
Mais c'est une hypothèse que je crois fondée, et qui, à mon sens, n'a rien d'incompatible avec la théorie de la Relativité. Je ne puis entreprendre la démonstration de ce pont. Il faudrait d'abord étudier beaucoup plus minutieusement que je ne viens de le faire la durée réelle et le temps mesurable. Il faudrait prendre un à un les termes qui entrent dans les formules de Lorentz et en chercher la signification concrète. On trouverait ainsi que les temps multiples dont il est question dans la théorie de la Relativité sont loin de pouvoir tous prétendre au même degré de réalité. À mesure qu'on avancerait dans cette étude, on verrait comment la conception relativiste, qui correspond au point de vue de la science, et la conception du sens commun, qui traduit en gros les données de l'intuition ou de la conscience, se complètent et se prêtent un mutuel appui. Il est vrai qu'il faudrait, chemin faisant, dissiper une confusion très grave, à laquelle certaines interprétations couramment acceptées de la théorie relativiste doivent leur forme paradoxale. Tout cela nous entraînerait trop loin.
Mais tout ce que je ne puis établir pour le temps en général, je vous demande la permission de le faire tout au moins entrevoir pour le cas particulier de la simultanéité. Ici l'on apercevra sans peine que le point de vue relativiste n'exclut pas le point de vue intuitif, et l'implique même nécessairement.
Qu'entend-on d'ordinaire par simultanéité de deux événements ? Je considérerai, pour simplifier, le cas de deux événements qui ne dureraient pas, qui ne seraient pas eux-mêmes des flux. Ceci posé, il est évident que simultanéité implique deux choses : 1° une perception instantanée ; 2° la possibilité, pour notre attention, de se partager sans se diviser. J'ouvre les yeux pour un moment : je perçois deux éclairs instantanés partant de deux points. Je les dis simultanés parce qu'ils sont un et deux à la fois : un, en tant que mon acte d'attention est indivisible, deux en tant que mon attention se répartit cependant entre eux et se dédouble sans se scinder. Comment l'acte d'attention peut-il être un ou plusieurs à volonté, tout d'un coup et tout à la fois ? Comment une oreille exercée perçoit-elle à chaque instant le son global donné par l'orchestre et démêle-t-elle pourtant, s'il lui plaît, les notes données par deux ou plusieurs instruments. Je ne me charge pas de l'expliquer ; c'est un des mystères de la vie psychologique. Je le constate simplement ; et je fais remarquer qu'en déclarant simultanées les notes données par plusieurs instruments nous exprimons : 1° que nous avons une perception instantanée de l'ensemble ; 2° que cet ensemble, indivisible si nous voulons, est divisible, si nous le voulons, aussi : il y a une perception unique, et il y en a néanmoins plusieurs. Telle est la simultanéité, au sens courant du mot. Elle est donnée intuitivement. Et elle est absolue, en ce qu'elle ne dépend d'aucune convention mathématique, d'aucune opération physique telle qu'un réglage d'horloges. Elle n'est jamais constatable, je le reconnais, qu'entre événements voisins. Mais le sens commun n'hésite pas à l'étendre à des événements aussi éloignés qu'on voudra l'un de l'autre. C'est qu'il se dit, instinctivement, que la distance n'est pas un absolu, qu'elle est «grande» ou «petite» selon le point de vue, selon le terme de comparaison, selon l'instrument ou l'organe de perception. Un surhomme à vision géante percevrait la simultanéité de deux événements instantanés «énormément éloignés» comme nous percevons celle de deux événements «voisins». Quand nous parlons de simultanéités absolues, quand nous nous représentons des coupes instantanées de l'univers qui cueilleraient, pour ainsi dire, des simultanéités définitives entre événements aussi distants qu'on voudra l'un de l'autre, c'est à cette conscience surhumaine, coextensive à la totalité des choses, que nous pensons.
Maintenant, il est incontestable que la simultanéité définie par la théorie de la Relativité est d'un tout autre ordre. Deux événements plus ou moins distants, appartenant à un même système S, sont dits ici simultanés quand ils s'accomplissent à la même heure, quand ils correspondent à une même indication donnée par les deux horloges qui se trouvent respectivement à côté de chacun d'eux. Or ces horloges ont été réglées l'une sur l'autre par un échange de signaux optiques, ou plus généralement électro-magnétiques, dans l'hypothèse que le signal faisait le même trajet à l'aller et au retour. Et il en est ainsi, sans aucun doute, si l'on se place au point de vue de l'observateur intérieur au système, qui le tient pour immobile. Mais l'observateur intérieur à un autre système S', en mouvement par rapport à S, prend pour système de référence son propre système, le tient pour immobile, et voit le premier en mouvement. Pour lui, les signaux qui vont et viennent entre deux horloges du système S ne font pas, en général, le même trajet à l'aller et au retour ; et par conséquent, pour lui, des événements qui s'accomplissent dans ce système quand les deux horloges marquent la même heure ne sont pas simultanés, ils sont successifs. Si l'on prend la simultanéité de ce biais – et c'est ce que fait la théorie de la Relativité – il est clair que la simultanéité n'a rien d'absolu, et que les mêmes événements sont simultanés ou successifs selon le point de vue d'où on les considère.
Mais, en posant cette seconde définition de la simultanéité, n'est-on pas obligé d'accepter la première ? N'admet-on pas implicitement celle-ci à côté de l'autre ? Appelons E et E' les deux événements que l'on compare, H et H' les horloges placées respectivement à côté de chacun d'eux. La simultanéité, au second sens du mot, existe quand H et H' marquent la même heure ; et elle est relative, parce qu'elle dépend de l'opération par laquelle ces deux horloges sont été réglées l'une sur l'autre. Mais, si telle est bien la simultanéité entre les indications des deux horloges H et H', en est-il ainsi de la simultanéité entre l'indication de l'horloge H et l'événement E, entre l'indication de l'horloge H' et l'événement E'? Évidemment non. La simultanéité entre l'événement et l'indication d'horloge est donnée par la perception qui les unit dans un acte indivisible; elle consiste essentiellement dans le fait, – indépendant de tout réglage d'horloges –, que cet acte est un ou deux à volonté. Si cette simultanéité-là n'existait pas, les horloges ne serviraient à rien. On n'en fabriquerait pas, ou du moins personne n'en achèterait. Car on n'en achète que pour savoir l'heure qu'il est; et «savoir l'heure qu'il est» consiste à constater une correspondance, non pas entre une indication d'horloge et une autre indication d'horloge, mais entre une indication d'horloge et le moment où l'on se trouve, l'événement qui s'accomplit, quelque chose enfin qui n'est pas une indication d'horloge.
Vous me direz que la simultanéité intuitivement constatée entre un événement quelconque et cet événement particulier qu'est une indication d'horloge est une simultanéité entre événements voisins, très voisins, et que la simultanéité dont vous vous occupez généralement est celle d'événements éloignés l'un de l'autre. Mais, encore une fois, où commence la proximité, où finit l'éloignement ? Des microbes savants, postés respectivement aux points E et H, trouveraient énorme la distance qui les sépare, c'est-à-dire la distance entre l'horloge et l'événement déclaré par vous «voisin». Ils construiraient des horloges microbiennes qu'ils synchroniseraient par un échange de signaux optiques. Et quand vous viendriez leur dire que votre œil constate purement et simplement une simultanéité entre l'événement E et l'indication de l'horloge H qui en est «voisine», ils vous répondraient : «Ah non ! nous n'admettons pas cela. Nous sommes plus einsteiniens que vous, Monsieur Einstein. Il n'y aura simultanéité entre l'événement E et l'indication de votre horloge humaine H que si nos horloges microbiennes, placées en E et en H, marquent la même heure ; et cette simultanéité pourra être succession pour un observateur extérieur à notre système ; elle n'aura rien d'intuitif ou d'absolu.»
Je n'élève d'ailleurs aucune objection contre votre définition de la simultanéité, pas plus que je n'en élève contre la théorie de la Relativité en général. Les observations que je viens de présenter (ou plutôt d'esquisser, car je serais entraîné fort loin si je voulais leur donner une forme rigoureuse) ont un tout autre objet. Ce que je veux établir est simplement ceci : une fois admise la théorie de la Relativité en tant que théorie physique, tout n'est pas fini. Il reste à déterminer la signification philosophique des concepts qu'elle introduit. Il reste à chercher jusqu'à quel point elle renonce à l'intuition, jusqu'à quel point elle y demeure attachée. Il reste à faire la part du réel et la part du conventionnel dans les résultats auxquels elle aboutit, ou plutôt dans les intermédiaires qu'elle établit entre la position et la solution du problème. En faisant ce travail pour ce qui concerne le Temps, on s'apercevra, je crois, que la théorie de la Relativité n'a rien d'incompatible avec les idées du sens commun.' (102-107)
'M. Bergson. – Je suis entièrement d'accord avec M. Piéron : la constatation psychologique d'une simultanéité est nécessairement imprécise. Mais, pour établir ce point par des expériences de laboratoire, c'est à des constatations psychologiques de simultanéité – imprécises encore – qu'il faut recourir : sans elles ne serait possible aucune lecture d'appareil.' (113)